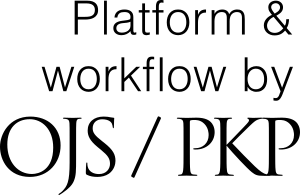La féminisation contrariée des professions judiciaires au Japon
Abstract
The purpose of this article is to examine the impact of the reform of the judicial system in Japan implemented in 2001, in accordance with the “womenomics” policy promoted by the Abe Cabinets. In this respect, the presence of three female judges at the Supreme Court was considered as a new step on the path of the feminization of the judiciary which was traditionally a bastion of masculinity.
This first part of this contribution deals with the general context of the policies advocated by the Prime minister in order to foster female employment at leading positions in Japan’s society, and the various measures and recommendations taken by the main actors of the judiciary – the Supreme Court, the Ministry of Justice, the Japan Federation of Bar Associations – in order to cope with the situation created by the enactment and the implementation of these policies and to lift the numerous cultural, psychological and financial obstacles which still impede the promotion of women in the judiciary. The second part is centred on demographical data depicting the evolution of the judiciary between 2005 and 2017, a period which coincides with the restructuring of the legal education system hinged on the reform of the national bar examination and the creation of law schools. The general data show a huge increase in the population of the judiciary, but unequally distributed between the three components of the judiciary − judges, public prosecutors and lawyers − which confirm that male dominancy, even slightly affected, remains a fundamental characteristic of the judiciary in Japan. But a more detailed analysis of the last cohorts of graduates from the Legal Training and Research Institute (LTRI) reveals a new trend: the proportion of women recruited as judges and public prosecutors has already reached the objective of 20% fixed by the government. Hence, the proportion of women in management and direction posts is still low with, for example, only twelve women as Supreme Court judges and presidents of tribunals, mainly because women have different paths of career and are less “performant” than male judges. The fourth part addresses some main gender issues in the judicial careers from a twofold perspective: the first is the fight against sexual harassment within the judiciary, some cases of which have been highlighted by the media. The second relates to the problem of conciliation of professional and family life. The article describes the initiatives launched by the three branches of the hōsō for the accommodation of professional constrains with the protection of privacy and family links, with a focus on child care leave which is currently under-utilized by men. The last part evokes an issue which recently emerged: how to make the judiciary more attractive for young people in an environment plagued by the constriction of the legal market and the crisis of recruitment both at the LTRI and the law school level. The article discusses the various proposals made by the bar associations, the Ministry of Justice and the Cabinet Office at the local level, aiming at deconstructing an image of the judiciary somewhat stuffed with stereotypes, with the objective of impelling young people, especially women, to join the judiciary.
The article concludes that the promotion of women in the judiciary should be studied not only through a quantitative, but a qualitative approach as well: a topic which cannot be dissociated from the eradication of the gender bias in Japanese positive law, the commitment of female lawyers in new fields of law still dominated by their male counterparts, and a new distribution of roles between males and females in Japanese society.
Resumé
Le but de cet article est d’examiner l’impact de la réforme de la justice mise en place à partir de 2001 en relation avec la politique dite de « womenomics » promue par les Cabinets Abe. La présence de trois femmes juges à la Cour suprême avait été considérée, à cet égard comme une nouvelle étape sur la voie de la féminisation de la justice, bastion traditionnel de la masculinité.
La première partie de cette contribution traite du contexte général des politiques avancées par le Premier ministre pour stimuler l’emploi féminin à des postes de responsabilité au Japon, ainsi que des mesures et recommandations diverses adoptées par les principaux acteurs de la justice – la Cour suprême, le ministère des Affaires Juridiques et la Fédération japonaise des associations du barreau, prises à cet effet, dans le but de lever les nombreux obstacles culturels, psychologiques et financiers qui continuent à entraver la promotion des femmes dans l’appareil judiciaire. La seconde partie est centrée sur des données démographiques décrivant l’évolution de la composition des milieux de la justice entre 2005 et 2017, période qui coïncide avec la restructuration du système de formation des professions judiciaires, notamment du régime de leur recrutement national et l’introduction des écoles de droit. Ces données générales font apparaître une augmentation sensible de la population judiciaire, qui, bien qu'inégalement répartie entre ses différentes branches – juges, procureurs et avocats – confirme que la domination masculine, même si elle est entamée, demeure une caractéristique fondamentale de l’organisation de la justice au Japon. Mais une analyse plus détaillée des dernières cohortes de diplômés du Centre national d’études judiciaires (CNEJ) fait apparaître une nouvelle tendance : la proportion de femmes recrutées comme juges et procureurs atteint voire dépasse les 20%, seuil fixé par le gouvernement. Néanmoins, la promotion de femmes à des postes à responsabilité demeure encore faible : seules douze femmes sont présidentes de tribunaux ou juges à la Cour suprême, une situation qui tient sans doute au fait que les femmes ont des parcours différents au sein de la magistrature et qu’elles sont moins « performantes » que leurs homologues masculins. La quatrième partie s’attache à quelques problématiques de genre dans la carrière des femmes, axées autour de deux points : d’une part, la lutte contre le harcèlement sexuel au sein de la magistrature, dont certains cas ont été dénoncés dans les médias, d’autre part la conciliation entre vie de famille et vie professionnelle. L’article décrit ainsi les dispositifs posés par les trois branches du hōsō pour faire en sorte que les contraintes professionnelles soient compatibles avec la vie privée et les liens familiaux avec, en point d’orgue, la question du congé parental, sous utilisé par les hommes. La cinquième partie parle d’une nouvelle problématique qui s’est récemment imposée : comment faire pour que les carrières judiciaires soient attractives pour la jeunesse, dans un environnement marqué à la fois par la réduction du « marché judiciaire » et la crise de recrutement qui affecte à la fois les écoles de droit et le CNEJ. L’article fait ainsi le point sur les divers dispositifs institués par le ministère des Affaires Juridiques, le barreau japonais et l’Office du Cabinet en vue de déconstruire les stéréotypes de la justice et d’inciter les jeunes, en particulier les jeunes filles, à embrasser une carrière judiciaire.
En conclusion, il est souligné que la promotion des femmes dans la justice n’est pas simplement qu’une affaire quantitative mais qualitative. Elle est indissociable de la levée des biais sexistes dans le droit positif, de la capacité des femmes à investir des champs juridiques nouveaux qui étaient jusque-là l’apanage des hommes et d’une meilleure répartition des rôles entre hommes et femmes dans la société japonaise.